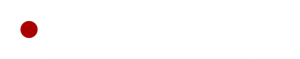Emmanuel Todd, c’est d’abord une voix discordante. Surtout dans sa propre patrie. D’où le choix du Japon comme terre d’édition première pour son nouvel essai, où les Japonais « tout aussi antirusses » n’ont pas tant que les Français l’habitude de le ranger parmi les auteurs sulfureux. L’Europe de l’Est y est plus lointaine, et ses ouvrages toujours accueillis, selon lui, avec intérêt. Il résume son attitude en une image parlante : « Il m’est pénible de parler en historien froid. Mais quand on pense à Jules César enfermant Vercingétorix dans Alésia, puis l’emmenant à Rome pour célébrer son triomphe, on ne se demande pas si les Romains étaient méchants, ou déficients par les valeurs ».
« Une sorte de quiproquo »
Fort de cette posture, il part d’un constat : « On pensait que l’Ukraine allait se faire écraser militairement et que la Russie se ferait écraser économiquement par l’Occident. Or il s’est passé l’inverse. » La résistance économique des Russes prend de court l’Occident tandis que le front, lui, s’enlise. Une telle méprise sur la réalité économique du pays s’expliquerait selon lui par de mauvaises mesures, et notamment le sacrosaint PIB. Celui des États-Unis, fondé sur « toute une économie de services mal définis, incluant la « production » de ses 15 à 20.000 économistes au salaire moyen de 120 000 dollars » n’a pas de quoi se vanter face à une Russie comptant « 30% de plus d’ingénieurs ».
Pourquoi global ? Car en s’appuyant sur le géopoliticien John Mearsheimer, il ajoute qu’avec son armée totalement prise en main dès 2014, l’Ukraine était « de facto membre de l’OTAN » et déjà perçue comme un glaive pointé vers la Russie. De même pour les bases avancées de l’OTAN : « Bakhmout est à 8400 kilomètres de Washington mais à 130 kilomètres de la frontière russe. » Il n’est pas illogique alors que les Russes conçoivent avant tout cette guerre comme « préventive et défensive ».
Des enjeux existentiels
Car côté russe, les enjeux sont absolument cruciaux : confronté à une Ukraine plus résistante qu’un fragile « failed state » en devenir, Vladimir Poutine doit « gagner la guerre en 5 ans, ou la perdre » pour une raison chère à Emmanuel Todd : la démographie. Avec 1,5 enfants par femmes, des générations creuses, la Russie mène « une économie de guerre partielle, mais en voulant préserver les hommes ». Pourquoi 5 ans ? « Une durée normale pour une guerre mondiale », estime-t-il, et le temps imparti pour réaliser l’objectif russe : effondrer les économies occidentales.
Une opinion lourde de conséquences si elle se vérifiait. Et pour cause : « La résistance de l’économie russe pousse le système impérial américain vers le précipice. » Sans revirement, les sanctions épuiseraient d’abord et avant tout l’Occident, et « les contrôles monétaire et financier américains du monde s’effondreraient, et avec eux la possibilité pour les États-Unis de financer pour rien leur énorme déficit commercial ».
L’aspect économique est donc primordial pour caractériser un conflit qui a, d’après lui, déjà débuté à grande échelle. Mais quelle drôle de guerre mondiale, si l’on compare aux boucheries planétaires du XXe siècle. Quid du sang et des larmes sur les cinq continents ? De la relative retenue des États ? « Nous fournissons des armes quand même. Nous tuons des Russes », rétorque-t-il. Malgré la paix qui règne encore dans les pays impliqués par les sanctions et les livraisons d’armes, l’impact réel sur les populations pourrait être désastreux.
L’équation est la suivante : si l’Amérique chancelle, l’Europe suivra dans l’instant, du fait de notre dépendance au pays d’oncle Joe. « La chute de notre autonomie est considérable, et rapide » estime-t-il. L’Irak en 2002, quand « Chirac, Schröder et Poutine faisaient des conférences de presse communes contre la guerre », était un chant du cygne d’une certaine forme d’autonomie diplomatique, et nous serions désormais liés à un camp occidental qui s’isole de plus en plus du reste du monde.
Choc idéologique : une tectonique des plaques explosive
Car enfin la guerre dépasse le simple cadre économique et militaire – à plus petite échelle – pour se jouer sur le plan culturel et idéologique. « Pour le non-Occident collectif, la Russie affirme un conservatisme moral rassurant, « patrilinéaire », contre les innovations occidentales néo-féministes, LGBT, transgenres… ». Ces facteurs n’éclipsent pas les intérêts économiques non-occidentaux, mais pourraient selon lui inciter des pays comme l’Arabie saoudite à soutenir indirectement l’économie russe. « Le conflit, décrit par nos médias comme un conflit de valeurs politiques, est à un niveau plus profond un conflit de valeurs anthropologiques. C’est cette inconscience et cette profondeur qui rendent la confrontation dangereuse. »
En un sens, le monde se bipolarise. D’un côté, ceux qui ne veulent pas de l’empire américain et le font savoir par leurs votes aux Nations Unies, où « 75% du monde ne suit pas l’Occident ». De l’autre, l’Otan et même certains pays historiquement neutres choisissent leur couleur sur le « Grand échiquier » – car l’auteur ne manque pas de citer Brzezinski. Les camps se cristallisent, et misent de plus en plus gros sur leur champion, otanien ou russe, qui mène une guerre pour l’existence.
Pas d’issue pacifique ou de retour à la normale après de tels bouleversements. Le train est lancé, alimenté par un moteur fou qui chauffera jusqu’à la casse. « Nous sommes désormais dans une guerre sans fin, dans un affrontement dont l’issue doit être l’effondrement de l’un ou de l’autre. Chinois, Indiens et Saoudiens, entre autres, jubilent. »