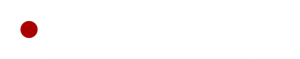J’ai été choqué d’apprendre, en lisant l’an dernier l’excellent livre d’Éric Branca L’ami américain, que le général de Gaulle n’avait jamais assisté aux commémorations du Débarquement en Normandie.
« Le débarquement du 6 juin, ç’a été l’affaire des Anglo-Saxons, disait de Gaulle à Alain Peyrefitte (« C’était de Gaulle » – tome II – chapitre 14) d’où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s’apprêtaient à le faire en Allemagne ! Ils avaient préparé leur AMGOT, qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l’avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis ». Cette citation m’a encore plus ébranlé que je m’étais toujours imaginé, du fait de mon éducation, que les bisbilles du général avec nos alliés d’Outre-Atlantique n’étaient que circonstancielles, la France étant fermement attachée au camp occidental depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
J’ai compris bien tard que les propos du général et plus généralement son combat, car c’était un combat, contre les Américains qui ira jusqu’à retirer la France du commandement intégré de l’OTAN en 1968, n’était en rien périphérique. Il participait au contraire d’une vision française et européenne propre des relations internationales basée sur l’indépendance et la reconnaissance de différences profondes, sur à peu près tous les sujets qui concernent la vie.
Cette réflexion m’a conduit à repenser aux longs échanges que j’avais eus au cours de ma carrière avec les militaires américains. Ayant vécu aux États-Unis, ayant accompagné les « boys » dans leurs guerres en Irak et en Afghanistan, j’avais occupé un poste clef pour comprendre l’indifférence que provoque chez eux l’évocation de la France et de l’Europe. Leurs femmes étaient plus réceptives, considérant les français comme « charming », peut-être parce que nous possédons une conception du sexe comme de la séduction et l’amour, et non comme une performance physique pure doublé d’un engagement à vie. Je peux comprendre que l’homme américain pour cela déjà ne nous aimait pas beaucoup. Mais il existe des divergences beaucoup plus profondes. Sur les terrains irakien et afghan donc, j’ai rencontré des généraux américains avec qui j’ai noué de véritables liens d’amitié. Stanley McCrystal, William McRaven, et bien sûr David Petraeus. De mes longues conversations avec ce dernier qui commencèrent un jour de juillet 2006 dans les faubourgs de Bagdad, je notais tout de suite un intérêt pour la France et ses gloires militaires. Mais il s’agissait, dans la bouche de Petraeus, bien davantage des hommes « héroïques » que de notre pays à proprement parler ou de quelconques épisodes militaires ou politiques que nous aurions partagés. Petraeus considérait le général Bigeard comme son mentor. Il admirait le capitaine Galula, auteur d’un magistral traité sur la contre-insurrection, qu’il avait sorti de l’anonymat pour le mettre en avant dans le manuel de terrain du soldat américain en 2005. Notons au passage que ce que Petraeus admirait chez nous, c’étaient les frondeurs, ceux qui avaient eu raison avant tout le monde et que la hiérarchie militaire traita finalement très mal. Bigeard fut accusé de la torture en Algérie, Galula dut s’exiler aux États-Unis où il publia d’ailleurs son livre en raison de sa confession israélite qui gênait visiblement l’État-major…
À ses yeux, en dehors d’un allié comme les autres, la France était une entité étrangère dont il connaissait à peine la culture profonde. C’était le cas de la plupart des Américains que j’ai rencontrés pendant mes huit années passées là-bas. Et je réalisais peu à peu que dans notre relation avec les États Unis, nous avions été, toutes ces années où je grandissais, plus demandeurs qu’eux. Nous avions cru au mythe du grand frère, de l’allié indéfectible quand en réalité, à leurs yeux, nous ne comptions nullement. Je me souviens pour illustrer encore davantage mon propos, et pour prendre le camp démocrate, de mes tentatives infructueuses pour obtenir une interview avec John Kerry en 2004 alors que je suivais depuis des semaines sa campagne. Kerry parlait français, mais il avait arrêté de s’exprimer dans notre langue parce que le camp républicain nous considérait comme des traîtres depuis que le tandem Villepin/Chirac avait fait défaut sur l’Irak. « Vous savez, en France, il n’y a aucune voie pour nous. Vous ne votez pas dans cette élection, alors vous ne nous intéressez pas », m’avait dit un conseiller de Kerry. L’indifférence vis-à-vis de la France est donc loin d’être une valeur trumpienne. Elle est partagée par toute la classe politique.
Lorsque je découvre aujourd’hui, après la volte-face de Trump, l’état de sidération dans lequel se trouvent ceux qui ont toujours défendu l’alliance atlantique dans notre pays, je ne suis pas surpris. Eux aussi ont cru au grand-frère. Le voilà qui nous abandonne en nous laissant pour mission de nous défendre nous-mêmes. Mais le revirement est brutal. Des décennies à compter sur Washington en premier et en dernier recours, ça laisse des traces. Surtout que, que ce soit en Ukraine ou dans le cadre de notre propre défense, ni la France, ni l’Europe, ne sont prêts à prendre la place…
Voir aussi : L’ami américain, documentaire de Régis Le Sommier