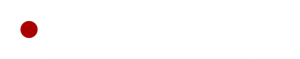Alors que le cap des cent jours à la Maison Blanche approche, il apparaît que l’action du président américain Donald Trump traverse une période d’incertitudes.
Cette manière de prendre tout le monde à la gorge, des tarifs douaniers à la guerre en Ukraine en passant par Gaza et l’Iran, jusqu’aux revendications territoriales visant le Groenland, le Canada et Panama, le bulldozer Trump a voulu écraser tout, mettre la concurrence KO debout.
Même s’il est encore trop tôt pour dire si, comme le prétend le locataire de la Maison Blanche, « l’Amérique va se transformer en paradis », il apparaît que, même chez ses partisans les plus acharnés, le manque de résultats tangibles dans les domaines concernés commence à semer le doute. La méthode d’abord. Prenons l’exemple de la guerre tarifaire, déclenchée unilatéralement par Trump avec le monde entier, mais surtout avec la Chine. Elle est typique du trumpisme économique et vise à convaincre les entreprises de s’implanter aux États Unis pour éviter ces taxes énormes. Après l’annonce par Trump de l’application d’une hausse douanière de 145%, avec la Chine qui elle-même a renchéri, on a assisté à ce que certains observateurs une reculade de Trump.
Or en réalité, Trump fait toujours ainsi. Il place d’emblée la barre très haute, appuie sa décision par des tweets rageurs et des déclarations dans lesquels ils se place au centre du jeu. Ainsi, il contraint tout le monde à se positionner contre lui mais psychologiquement, c’est lui qui garde la main tout le temps, contrôle le langage, dépeint ses adversaires comme faibles et incompétents. Puis il laisse planer le doute. Va-t-il renchérir, va-t-il maintenir ses décisions extravagantes ? De bout en bout, il sème le chaos et prospère sur l’incertitude qu’il a lui-même créée. Puis il ralentit, revoit ses objectifs à la baisse et proclame la victoire. En général, il s’en tire en gagnant bien plus que les observateurs le pensaient à l’origine.
Sur l’Ukraine, l’affaire semble plus compliquée cependant. Pourtant, ce que recherche Trump avant tout, c’est d’éviter d’avoir à supporter une défaite. Il souhaitait l’attribuer à l’équipe précédente, Joe Biden en tête. Il veut maintenant qu’elle devienne celle des Européens qu’il déteste. Ce n’est pas simplement le caprice de quelqu’un qui n’est pas parvenu à arrêter la guerre et à remplir sa promesse de campagne, c’est une longue tradition toute américaine de se désengager d’un problème lorsque celui-ci n’est pas solvable. À noter que l’intransigeance des Ukrainiens et leur refus du plan de paix américain, avec le soutien des Européens, risque dans quelque mois de les mettre face à l’obligation cette fois de signer un accord bien plus désavantageux. Comme le dit l’ex-conseiller du président Zelensky, Oleksiy Arestovytch : « à ce moment-là, ce ne seront pas quatre régions qu’il faudra céder mais peut-être huit… » À ce moment-là, Trump sera loin et l’Ukraine se retrouvera bien seule face à Poutine. Trump aura réussi son affaire : éviter d’être associé à la défaite.
Quand on regarde les choses sur le long terme, on se rend compte que les Etats-Unis d’Amérique ont presque toujours agi comme Trump le fait aujourd’hui, misant continuellement sur un échange entre protection militaire et vassalisation économique. La différence entre Trump et ses prédécesseurs n’est que dans la forme. « Les amendes colossales contre BNP Paribas-Airbus en France, Siemens, Deutsche Telekom, Daimler en Allemagne, BAE-Rolls-Royce en Angleterre, ENI en Italie et bien d’autres, les rachats d’Alstom et de Technip, l’espionnage massif de la NSA révélé par Snowden, l’affaire Aukus, qui nous a coûté la vente des sous-marins à l’Australie, le programme d’ « Inflation Reduction Act », incitant les entreprises européennes à se délocaliser aux États-Unis en échange d’aides fiscales importantes : toutes ces attaques en règle contre les « alliés » européens ont été le fruit des administrations démocrates Obama-Biden », rappelle Frédéric Pierucci qui sait de quoi il parle. Il fut en effet ancien cadre supérieur d’Alstom, président monde de la division chaudière de l’entreprise, accusé de corruption en 2013 par le gouvernement américain, arrêté puis emprisonné à ce titre deux années aux États-Unis.
Face à tout cela, l’Union européenne n’a en réalité jamais réagi vraiment. Cette fois-ci, la rupture Europe/Amérique est plus marquée et semble devoir s’inscrire dans la durée. Trump nous force, en quelque sorte, à prendre nos destins en main. Quant à son action, elle se poursuit, même si en apparence, le bulldozer connaît les premières difficultés. Elon Musk, le monsieur propre de la fonction publique aux USA, rentre sagement à la niche Tesla, en grandes difficultés. Dans les sondages, Trump est en baisse. Mais affirmer qu’il serait au bord de l’échec reste bien présomptueux. Trump est un « gambler », un joueur. Il a placé sa mise et attend le résultat. Sur la guerre douanière comme sur l’Ukraine, méfiance ! Il n’a certainement pas dit son dernier mot.